Grande Tchatche avec Michel Péraldi et Michel Samson : “Le Printemps marseillais n’est pas un coquelicot”
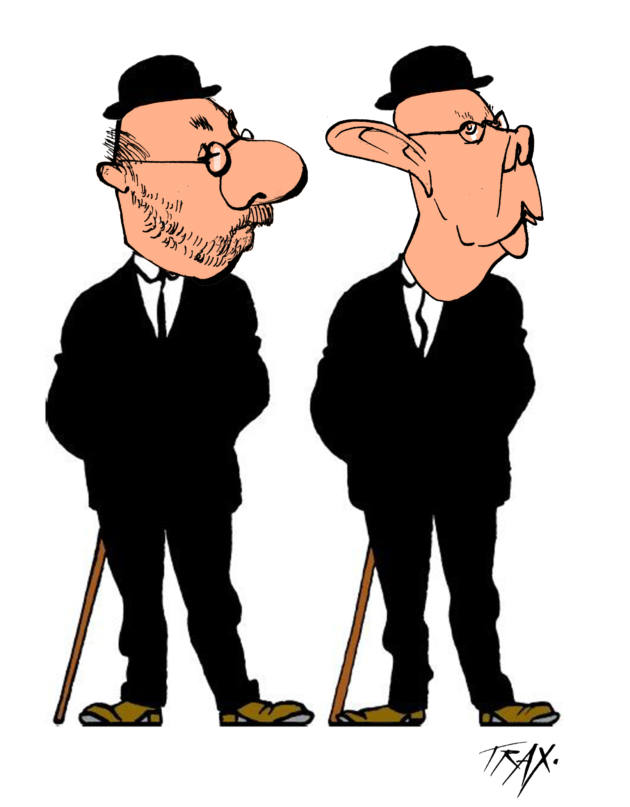
Nommer Michèle Rubirola “la Bonne Maire”, c’est juste un jeu de mot pour concurrencer le Ravi ?
Michel Peraldi : C’est une marque de sympathie. Au-delà de ses positions politiques, Michèle Rubirola est un nouveau personnage. Une nouvelle manière d’être dans l’espace public de la politique. On voulait le signaler.
Par contre, selon vous, qualifier la nouvelle maire de Marseille de novice est une grossière erreur…
M. P. : Le noviciat n’existe pas en politique. On souligne dans Marseille Nouvelle Vague que Rubirola, sans être un vieux notable, vient de la liste de Pape Diouf [« Changer la donne » en 2014 ndlr], une sorte de répétition du Printemps Marseillais.
Pourquoi analyser le « phénomène » Michèle Rubirola sur le plan émotionnel ?
Michel Samson : Les questions d’émotivité sont souvent négligées par les sociologues et les journalistes. La façon de se comporter, de s’habiller, de pleurer : ça compte beaucoup. Si on regarde les mouvements sociaux et politiques dans la ville de Marseille – comme ailleurs – ils viennent aussi des affects. C’est bien à cause de la mort de 8 personnes, et de l’émotion suscitée [l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne en 2018 ndlr] que renaissent des collectifs urbains. Madame Rubirola incarnait cette émotion de façon spontanée et volontaire. Elle est émue quand elle embrasse Gaudin (lors de son investiture, Ndlr). Elle est gentille avec lui. Et le vieux Gaudin est tout ému aussi. Cela fait partie des choses qui méritent d’être décrites quand on s’intéresse vraiment à la politique.
Toujours sur ce registre des émotions, la faiblesse, supposée, de Michèle Rubirola a agité la campagne…
M. S. : C’était présent. Lorsqu’elle refuse un débat avec Martine Vassal… Mais ce qui fait qu’elle gagne de 10 000 voix au premier tour c’est autre chose ! Michèle Rubirola a su prendre la tête d’un conglomérat étrange, qui mélange des jeunes qui découvrent la politique, des acteurs des collectifs urbains et des politiciens à l’ancienne. Il y a eu une fusion réelle des âges et des générations différentes.
Certains redoutent, ou espèrent, que Michèle Rubirola se fasse “manger” par les nombreux « professionnels » de la politique que compte le Printemps marseillais. Qu’en pensez-vous ?
M. P. : Bien malin qui peut le dire. Ces trois dernières années devraient nous enseigner la prudence. Rubirola est une figure. Mais derrière, il y a un vrai collectif qui est en train de se former dans lequel sont aussi pris les vieux politiciens classiques. Il ne faut pas leur donner trop de puissance. Ils sont absorbés dans une machine qui va les modifier eux aussi.
Cette élection illustre aussi la défaite de la quasi totalité des mouvements politiques, traditionnels ou même émergents…
M. S. : Les deux formations politiques nouvelles apparues dans le paysage politique marseillais, à savoir la France insoumise (LFI) et la République en marche (LREM), ont fondu dans la campagne. LREM, c’est une catastrophe ! Ils n’ont été au second tour que dans un seul secteur. Et ils font 8 %… Une partie importante des acteurs de la LREM venaient sincèrement de la gauche. Ceux-là ne se sont pas battus contre leur propre parti mais ils étaient absents. Pour LFI c’est le même processus. Mais avec des militants en plus ! Et aujourd’hui, beaucoup d’entre eux sont d’ailleurs aux affaires (aux côtés du Printemps marseillais, Ndlr)…
L’abstention, la Covid, la crise de succession, la division des gauches au nord de la ville, n’ont pourtant pas profité à l’extrême droite…
M. P. : Tant mieux ! Ils ont réussi à s’ancrer dans un électorat. Une partie de la population se reconnaît politiquement dans les éructations du RN et dans cette conception très guerrière de la politique. Mais en même temps, ils n’arrivent pas – ou ne veulent pas – devenir une sorte d’ami incontournable de la droite aujourd’hui. Le RN va tout seul au combat dans un système politique de plus en plus complexe où l’on meurt sans alliance. Voilà pourquoi ils ont perdu la mairie du 13 et 14ème arrondissement.
À propos de la défaite de Martine Vassal, vous n’hésitez pas à parler d’une « campagne ringarde »...
M. P. : Ce sont les conditions même du théâtre politique qui ont changé en France. La personnalité médiatique, cet avatar que produisent les hommes et femmes politiques, est devenu essentiel pour être élu. De ce point de vue, Martine Vassal a loupé sa construction. Sa campagne relève du paléolithique de la politique où seuls les discours en public comptent. Mais il me semble que Marseille était un baroud d’honneur. La droite a accumulé une puissance politique assez phénoménale : la Métropole, le Conseil général, le Conseil régional. J’ai l’impression que la Ville c’était pour avoir un peu plus de puissance. Ce n’est peut-être qu’une péripétie.
M. S. : En face, la mobilisation a été plus massive que prévue. Avec les effondrements de la rue d’Aubagne est née une mobilisation chez des gens qui souvent ne votaient pas. Ils se sont motivés parce qu’ils tenaient la mairie pour responsable de la catastrophe. Les trois grandes manifestations après les effondrements sont les plus importantes pour un sujet local depuis la mort d’Ibrahim Ali [Marseillais d’origine comorienne tué par des colleurs d’affiches du Front national en 1995 ndlr]. Ça rejoint ce que l’on disait sur l’émotion.
La genèse du Printemps marseillais a pourtant été rocambolesque. Elle est passée par des réticences, des doutes… Le mouvement a même été accusé d’avoir volé une dynamique qui le dépassait.
M. S. : Effectivement, ça s’engueulait… Ce bouillonnement s’est traduit par des gens qui ont annoncé qu’ils n’iraient pas aux élections. Une partie du collectif Noailles par exemple. Il y a eu des divergences énormes. Mais entre les deux tours, une espèce de fusion s’est faite. Peu à peu les gens se sont parlés et se sont rendus compte que, sans ça, Gaudin allait rester.
M. P. : La nouvelle donne marseillaise est le produit de vingt ans d’Histoire. Les dernières municipales ont été la manifestation d’une vraie rupture. Non seulement à l’intérieur de la droite locale, mais aussi au sein de la bourgeoisie qui les porte. Il faut insister sur l’inertie des scores électoraux à Marseille : ça se joue sur de tout petits écarts. Il a suffit qu’une partie de la vieille démocratie chrétienne abandonne Gaudin pour que Printemps Marseillais émerge. Sans leur voler la victoire, c’est aussi massivement le produit de la défaite de la droite.
Toutefois, à Marseille, seuls 20,62 % des votants se sont exprimés au second tour…
M. P. : C’est lié à trois phénomènes. D’abord, l’abstentionnisme des mondes populaires dans les quartiers nord. Le deuxième phénomène, conjoncturel, c’est l’abstention des plus de 60 ans à cause des risques sanitaires, majoritairement l’électorat de la droite. Le troisième phénomène est le plus compliqué à analyser : une partie des gens sont citadins sans pour autant être citoyens. Ils vivent à Marseille, mais ne votent pas. L’exemple type, ce sont les étudiants. Ils sont 60 000, l’une des principales composantes socio-démographiques de la population marseillaise. C’est plus que les ouvriers. Est-ce qu’ils votent ? Beaucoup moins que les autres.
M. S. : Mais ces étudiants sont massivement présents dans le quartier de la rue d’Aubagne. Sophie Camard [maire du 1er et 7ème arrondissements ndlr] fait plus de 80 % des votants dans les trois bureaux autour de la rue d’Aubagne. C’est bien eux, les étudiants, qui sont allés voter.
Vous soulignez qu’il n’y a jamais eu, depuis 50 ans, autant de professionnels de la politique parmi les adjoints de la nouvelle majorité du Printemps marseillais. Surprenant ?
M. P. : Ce grignotage de la politique par les professionnels, c’est une vieille histoire qui se concrétise… Cela montre bien que le Printemps marseillais n’est pas un coquelicot qui a émergé au milieu d’un champ de blé. Il est porté par des tendances lourdes. Sur le plan national, la présence des professionnels est manifeste dans toutes les campagnes de la gauche. Ayant perdu beaucoup d’élections, le phénomène n’était pas visible…
Par contre, une autre famille, moins attendue à Marseille, est aussi bien présente. C’est celle que vous appelez des “créatifs”. Qui sont-ils ?
M. P. : C’est la nouveauté de cette élection. Ce sont des gens qui, d’une manière ou d’une autre, sont des professionnels de la culture au sens large. Les journalistes, les gens impliqués dans Plus belle la vie, dans la Friche la Belle de Mai… Ce sont toutes les industries culturelles qui sont porteuses de types d’emplois particuliers. La droite a été incapable de mobiliser ces gens-là, sauf du côté des arts décoratifs, de la peinture… C’est une des raisons de leur défaite.
M. S. : Gaudin et Vassal ignoraient absolument l’existence de ce champ-là. Pour avoir assisté à un conseil municipal à propos de la rue d’Aubagne, j’avais l’impression qu’ils n’y avaient jamais mis les pieds. Ils s’en foutent des gens qui y résident : ils ne les connaissent pas.
Et quel est le pendant des « créatifs » ?
M. P. : En face des créatifs, il y a une petite bourgeoisie affairiste et subalterne. Des promoteurs immobiliers, des croisiéristes… Ce sont les sortants politiquement. Il y a une nouvelle dialectique. Les vieilles élites – c’est-à-dire les cadres supérieurs, les hauts fonctionnaires et les professions libérales – se sont fractionnées. Une partie a basculé dans le camp des affairistes, l’autre dans celui des créatifs. Les élections à Marseille sont révélatrices de ce nouveau front de classes inédit sur 400 ans d’histoire locale.
Vous soulignez aussi le grand retour de la fonction publique dans cette nouvelle municipalité…
M. P. : Les avocats, les médecins et les professeurs sont, depuis l’invention de la démocratie représentative, les catégories classiques dans lesquelles les politiques vont chercher leurs représentants. C’est un phénomène de conversion de réputation. Quand on est un médecin connu, c’est plus facile d’être élu. Gaudin a rompu avec ça. Ce n’est pas une petite affaire. Je pense que les historiens dans vingt – vingt-cinq ans diront qu’il y a eu une sorte de hold-up de la petite bourgeoisie affairiste. Car cette catégorie a disparu dans les années 2000 de la représentation politique. Aujourd’hui, en observant la composition des élus du Printemps Marseillais, c’est presque une revanche des fonctionnaires publics.
Cependant, un monde demeure absent de la représentation incarnée par le Printemps marseillais : celui des catégories populaires...
M. S. : Il y a un peu plus de non-chrétien sur les 101 (conseillers municipaux, ndlr). Ça compte ! Ce n’est pas nouveau (l’absence des catégories populaires), mais ça continue. Par contre, le conseil municipal promet de s’en occuper. Je constate que quand il y a un camp de Roms qui brûle, ils les relogent tout de suite. La nouvelle majorité est présente sur ces questions. Mais est-ce que ça va tenir ?
M. P. : Il faut réinventer le contrat social . Avant, il y avait des intérêts commun entre ouvriers et bourgeois. Aujourd’hui, où sont-ils ? Les travailleurs précaires (l’une des composantes des « créatifs » du Printemps marseillais selon Samson et Péraldi, Ndlr) sont des médiateurs sociaux formidables qu’il faut utiliser pour trouver de nouvelles manières d’être entre les mondes populaires et les élites.
Propos recueillis par Michel Gairaud et mis en forme par Samuel Vivant






